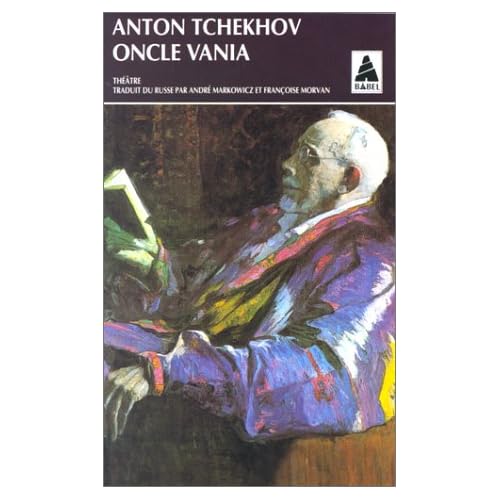"Elle m'aime !"
Les Souffrances du Jeune Werther
Johann Wolfgang Von Goethe
traduction Bernard Groethuysen
Gallimard, coll. Folio, 1973
192 p.
Il y a quelques jours, quand je lui en ai parlé, un ami m'a dit que j'étais trop vieille pour lire ça. Sur le coup, je me suis dit que c'était bizarre comme réflexion, qu'un livre valait le coup d'être lu à n'importe quel âge. Et puis j'ai compris ce qu'il a voulu dire.
Les Souffrances du Jeune Werther, c'est typiquement le genre de livre qu'il faut lire à l'adolescence, à l'âge où une foule de sentiments nouveaux nous tombent dessus, nous occupent, nous envahissent, nous déboussolent. A l'âge où l'idée de se suicider par amour n'est ni inconcevable, ni ridicule. A l'âge où l'on est inconsolable lorsqu'on a perdu celui ou celle qu'on croyait aimer. "Mais oublie-le, oublie-la, tu as toute la vie devant toi !" Oui, mais justement ! C'est toute cette vie devant soi, sans lui, sans elle, qui fait peur et qu'on a envie d'effacer.
La légende dit que lors de la sortie du livre (1774) qui a été un succès, il y a eu une vague de suicides inexpliqués...
Bon après, je ne sais pas si tous les adolescents passent par cette phase-là, mais Werther, en tout cas, il est comme ça. Passionné, sensible, déchiré, lyrique, extrême (de n'importe quel sentiment, mais extrême). Un artiste et un poète de la plus pure tradition romantique. Il ne fait rien de sa vie, il se promène dans la nature, voyage de ville en ville, et fait des descriptions aussi inspirées que passionnées d'une "douce matinée de printemps", ou bien du paysage qu'il a devant lui, et qui est toujours une vallée, parce que lui est toujours en haut d'une montagne (et oui... quand je dis romantique, c'est romantique !) Pour ceux pour qui ça ne fait pas *tilt*, jetez un coup d'oeil à
ce tableau ou
ce tableau de Friedrich.
Archétype du romantisme allemand, le
Sturm and Drang dans toute sa splendeur.
C'est beau non ?
Oui c'est beau, mais justement, du beau comme ça, ça ne se lit pas dans le métro. Or non seulement j'étais trop vieille, mais en plus je l'ai lu dans le métro. Et croyez-moi, quand mes yeux lisent du Goethe en même temps que mes oreilles entendent du ça :
"- tu m'étonnes c'est une bouffonne c'te meuf
- crari, elle a voulu s'le tapper, si j'la vois j'la butte
- vas-y...."
etc..., je vous épargne la suite du dialogue, mais vous avez compris que ça crée une sorte de... DECALAGE. J'ai donné cet exemple, mais ça a aussi été 2 mamans qui se vantent mutuellement les progrès phé-no-mé-naux de leurs rejetons respectifs (sans s'écouter l'une l'autre) ou un jeune cadre surdynamique qui hurle à son téléphone que "les délais c'est les délais bordel, tu te démerdes il me la faut demain cette étude de marché !!", l'effet est le même. Donc à moins d'avoir une puissance d'immersion dans le bouquin extranormale, ou des boules quies (mais bon dans le métro... voilà quoi), c'est difficile de vraiment rentrer dedans s'il y a des gens qui nous embêtent autour...
Alors conseil : si jamais vous voulez le lire, faites-vous un petit cocon tout seul quelque part, je suis sûre que ça sera beaucoup mieux. Pour lire ça, faut ouvrir les chakras, comme dirait l'autre...
Malgré tout, j'ai quand même beaucoup aimé ! Les histoires d'amour c'est toujours bien... et les histoires d'amour malheureux c'est toujours beau. C'est idiot, hein ? ça devrait être le contraire. Mais non, c'est souvent de la souffrance que ressort la beauté. D'ailleurs, Werther le dit à un moment dans une de ses lettres : il se plaint d'être trop heureux et que ça nuit à son talent (maso ? vous avez dit maso ? meuh non, artiste, tout simplement...)
Mais pas de panique, il ne reste pas longtemps heureux... ce n'est pas son destin, et puis ce n'est pas comme ça que ça marche.
Et puis alors comme il est triste et qu'il n'a rien à faire (ce qui est la pire chose, quand on est triste), il décide d'avoir quelque chose à faire. Et là, comme ça se faisait à l'époque (pour les riches, hein on est bien d'accord), en trois coups de cuiller à pot le voilà diplomate attaché à l'Ambassadeur. Et comment il le raconte, ça a l'air très facile. J'aimerais bien moi, pouvoir me dire "bon je m'ennuie un peu, et si j'étais diplomate à partir de demain ?"
Mais aujourd'hui, on dirait que c'est pas comme ça que ça marche... (quoi que... on serait peut-être surpris si on regardait vraiment le parcours de nos diplomates...)
Mais bref la question n'est pas là.
La question est en fait une réponse : Oui, ce livre est magnifique, très bien écrit, c'est un des textes fondateurs du romantisme, et il vaut la peine d'être lu à mon âge et à n'importe quel âge !
"Werther. Je me souviens de l'avoir lu et relu dans ma première jeunesse pendant l'hiver, dans les âpres montagnes de mon pays, et les impressions que ces lectures ont faites sur moi ne se sont jamais ni effacées ni refroidies. La mélancolie des grandes passions s'est inoculée en moi par ce livre. J'ai touché avec lui au fond de l'abîme humain... Il faut avoir dix âmes pour s'emparer ainsi de celle de tout un siècle."
Lamartine.
Bon ok, Lamartine, il en parle vachement mieux que moi, et en plus, lui il a vraiment senti tout ce qu'il y avait à sentir. Mais forcément, il prenait pas le métro, lui ! Il prenait la montagne.
Tiens, ça me donne envie de le relire pour m'y plonger pour de vrai. Et oh miracle ! J'ai justement toute la nuit devant moi et pas besoin de me lever demain ! :)
 My Blueberry Nights
My Blueberry Nights